
Le bon comédien ne doit jamais chanter.
Jean de La Fontaine (Footnote: Jean de La Fontaine, Épître XII. Sur l’Opéra, à M. de Nyert, Oeuvres complètes, p. 542-545.).
Entreprendre de retracer, dans le domaine du chant français, l’histoire de ce que, par abus et tradition, l’on nomme « prosodie », mais qu’il est certainement plus précis, à défaut d’un terme spécifique (Footnote: Au sens strict, la prosodie est la partie de la linguistique qui traite des phénomènes dits « suprasegmentaux » : en gros, l’accent, l’intonation et, s’il y a lieu, la quantité (ou longueur) des syllabes. Elle concerne, si l’on veut, la musique propre de la langue, mais elle se passe complètement de la musique proprement dite, celle des compositeurs et des chanteurs.), d’appeler lien texte-musique, c’est s’engager dans un cheminement tortueux, obscur et semé d’embûches. Aux détours de cet itinéraire chaotique se dressent deux éminences inespérées d’où le chercheur égaré aperçoit une lueur susceptible de le mettre sur la voie. Ces deux infimes balises sont celles laissées par Jean-Antoine de Baïf, avec ses vers mesurés, et Bertrand (Footnote: Les documents d’archives établissent que le prénom civil de Bacilly était Bertrand et non Bénigne comme le veut une tradition plus récente. Voir la communication de Frédéric Michel à la journée « Bacilly » de Tours (novembre 2008) ainsi que Laurent Guillo et Frédéric Michel, Nouveaux documents sur le maître de chant Bertrand de Bacilly.) de Bacilly qui fait l’objet du présent article. Elles sont les seules occasions offertes audit chercheur de faire halte pour scruter de manière systématique les relations qui peuvent exister entre une théorie structurée (Footnote: Baïf n’a pas laissé d’écrit théorique, mais on peut espérer reconstruire sa théorie personnelle sur la base de la métrique gréco-latine, largement officielle, et de sa pratique orthographique propre, telle que la transcrit mon édition électronique. ) et une production pratique, poétique ou musicale, qui lui correspond. Encore faudra-t-il pour cela qu’il se donne la force de résister à bien des sirènes au premier rang desquelles figurent ses propres préjugés.
En analysant l’écrit théorique de Bacilly, il a été possible de dégager six principes « quantitatifs » (Footnote: Pour une explicitation détaillée de la théorie de Bacilly, le lecteur voudra bien se reporter à Bettens, Les Bigarrures du Seigneur Bénigne, qui constitue la première étape de la démarche poursuivie dans le présent chapitre et dont la lecture préalable est vivement encouragée. On se réfère ici à l’édition de 1679 de L’Art de bien chanter dont la troisième partie est entièrement consacrée au problème de la « quantité » des syllabes. Merci à Frédéric Michel qui m’a donné accès aux éditions antérieures de 1668 et 1671.). Appliqués l’un après l’autre aux suites de syllabes indistinctes, et donc a priori toutes brèves, que constituent les paroles de musiques, ils permettent au « lecteur », c’est-à-dire au compositeur ou au chanteur, d’en privilégier certaines selon des critères soigneusement choisis. Lorsqu’elles seront déclamées — une déclamation peut être parlée ou chantée — tout ou partie de ces syllabes privilégiées se verront conférer un poids particulier et on pourra les qualifier de « longues ».
À titre d’illustration, on se propose d’appliquer séparément ces six principes à quelques vers tirés de l’Armide de Quinault.
1. Quantité « métrique » :
Ah ! quelle cruauté // de luy ravir le jour
A ce jeune Heros // tout cêde sur la Terre.
Qui croiroit qu’il fut né // seulement pour la guerre ?
Il semble être fait pour l’amour.
Dans sa forme la plus ancestrale, ce principe consistait à « encadrer » le mètre en en privilégiant les syllabes remarquables, ou contraintes, à savoir la première et la dernière syllabe numéraire de chaque vers ou sous-vers (Footnote: Les vers composés, à savoir le décasyllabe et l’alexandrin, comportent deux sous-vers de quatre et six syllabes pour le premier et de deux fois six syllabes pour le second. On admet aisément que les dernières positions numéraires des sous-vers (césure et rime), qui ne peuvent accueillir que la dernière syllabe non féminine d’un mot, ou plutôt d’un groupe de mots constituant une unité de sens ou de rythme, soient de ce fait considérées comme contraintes. La même contrainte se répercute sur l’éventuelle syllabe surnuméraire, obligatoirement féminine. Quant aux premières syllabes des sous-vers, on remarque que, selon les règles classiques, elles doivent obligatoirement coïncider avec le début d’un groupe : on ne peut donc les considérer comme libres.), ainsi que l’éventuelle syllabe féminine surnuméraire (vv. 2 et 3 de l’exemple). Bacilly ne le mentionne que très brièvement et n’en donne qu’une version édulcorée et incomplète qui passe en particulier sous silence la première syllabe des sous-vers. Ci dessus, il est au contraire mis en application de la manière la plus radicale et sévère qui soit, comme aurait pu le faire fait le psautier huguenot du xvie siècle.
2. Quantité « syntaxique » :
Ah ! quelle cruauté // de luy ravir le jour
A ce jeune Heros // tout cêde sur la Terre.
Qui croiroit qu’il fut né // seulement pour la guerre ?
Il semble être fait pour l’amour.
Selon Bacilly, on privilégie les syllabes qui sont arrêtées par un signe de ponctuation ou qui marquent « la fin d’un sens » ou un « repos ». Comme il n’est pas possible de savoir précisément ce qu’il entend par ces deux termes, la solution présentée ci-dessus n’en est qu’une parmi plusieurs possibles. Appliqué de manière littérale à des mots à terminaison féminine en dehors de l’élision, ce principe en sélectionne la finale atone et non la pénultième accentuée (par exemple, celle de cêde au v. 2).
3. Quantité « accentuelle » :
Ah ! quelle cruauté // de luy ravir le jour
A ce jeune Heros // tout cêde sur la Terre.
Qui croiroit qu’il fut né // seulement pour la guerre ?
Il semble être fait pour l’amour.
Ce principe semble bien venir corriger ce qu’il est tentant d’interpréter comme une insuffisance du principe 2. Il sélectionne en effet les pénultièmes accentuées des mots féminins que celui-ci a « oubliées ». Mais Bacilly n’en limite pas expressément la portée à la fin d’un sens, raison pour laquelle on n’a pas hésité à souligner ici les pénultièmes de quelle (v. 1) ou de jeune (v. 2). Il ne s’applique par contre pas systématiquement lorsque l’e féminin subséquent est élidé, comme dans semble (v. 4) (Footnote: Si cette syllabe est, à l’arrivée, quand-même longue, cela sera plus en vertu du principe 5 que du principe 3.). Combinés, les principes 2 et 3 tendent à mettre en évidence une proportion importante des syllabes qu’une analyse moderne considérerait comme porteuses d’un accent tonique (Footnote: Par définition, l’accent tonique frappe la dernière syllabe des mots à terminaison masculine et la pénultième syllabe des mots à terminaison féminine, à l’exception de celles des clitiques, mots grammaticaux ne portant pas d’accent propre et qui se joignent aux mots principaux pour former des groupes accentuels. La notion d’accent tonique et son application au français ne se sont imposées qu’au XIXe siècle.) et qu’on qualifiera ici d’accentuées.
4. Quantité « phonologique » :
Ah ! quelle cruauté // de luy ravir le jour
A ce jeune Heros // tout cêde sur la Terre.
Qui croiroit qu’il fut né // seulement pour la guerre ?
Il semble être fait pour l’amour.
On présume que, dans une situation de conversation habituelle, un locuteur partageant la langue de Bacilly aurait pu percevoir comme longues les voyelles soulignées ici. Ainsi par exemple aurait-il marqué et reconnu une distinction entre mettre (première syllabe brève) et m’être (première syllabe longue), ce dernier terme se confondant par contre avec maître. Certainement aurait-il aussi distingué fut (indicatif), bref de fût (subjonctif), long.
5. Quantité « par position » :
Ah ! quelle cruauté // de luy ravir le jour
A ce jeune Heros // tout cêde sur la Terre.
Qui croiroit qu’il fut né // seulement pour la guerre ?
Il semble être fait pour l’amour.
Selon ce principe, toute syllabe fermée, c’est-à-dire terminée par une consonne qu’on peut qualifier d’implosive (Footnote: Elle prend place en fin de syllabe, après le noyau vocalique et, s’il y a lieu, avant la consonne initiale de la syllabe suivante.), est susceptible d’être privilégiée. Il est possible, comme ici, de l’appliquer sur des bases graphiques, ou alors de ne prendre en compte que les consonnes qui sont effectivement prononcées, auquel cas tout (v. 2), croiroit, fut (v. 3), fait (v. 4) ne devraient par exemple pas être mis en évidence. Bacilly ne tranche pas clairement entre une application graphique large, ou alors plus strictement phonétique, de ce principe. On croit toutefois comprendre qu’il en exclut les consonnes géminées (quelle, v. 1) qui, -rr- excepté, ne correspondent pas en français à des consones phonétiquement dédoublées. Il l’applique en revanche de manière systématique aux voyelles nasales qui constituent, au moins graphiquement, des syllabes fermées.
6. Symétrie :
Ah ! quelle cruauté // de luy ravir le jour
A ce jeune Heros // tout cêde sur la Terre.
Qui croiroit qu’il fut né // seulement pour la guerre ?
Il semble être fait pour l’amour.
Lorsque subsistent, après l’application des cinq premiers principes, plusieurs syllabes brèves consécutives, Bacilly suggère qu’on en allonge une sur deux, en rétrogradant depuis la première longue qui suit. À titre d’exemple, on a ici mécaniquement appliqué la symétrie à l’ensemble du vers ou du sous-vers en rétrogradant depuis la rime et la césure. La théorie de Bacilly, quant à elle, en prescrit bien sûr une application beaucoup plus subtile.
Bacilly n’a pas tiré sa théorie du néant : d’une part, on en trouve la trace dans la pratique musicale antérieure qui a pu lui servir de modèle ; d’autre part, du strict point de vue de la langue, ses principes ne sont de loin pas dénués de toute pertinence (tableau 1).
| Ancrage à la musique | Ancrage aux paroles | |
| Quantité « par symétrie » | Renaissance (?) | Artifice |
| Quantité « par position » | Académie 1570 | Texte |
| Quantité « phonologique » | Académie 1570 | Langue |
| Quantité « accentuelle » | Académie 1570 | Langue |
| Quantité « syntaxique » | Renaissance (?) | Langue |
| Quantité « métrique » | Ancestral | Mètre syllabique |
Le premier, celui de la quantité « métrique », est aussi le plus anciennement inscrit dans la tradition du chant. Comme l’a déjà relevé Jean-Pierre Ouvrard (Footnote: Ouvrard, Les Jeux du mètre.), la lecture métrique des textes poétiques est un donné de la chanson de la Renaissance, présent bien avant que les compositeurs ne se soient souciés de se calquer plus précisément sur les paroles. À l’époque de Bacilly, elle ne subsiste que sous forme de vestige (la mise en évidence des premières syllabes des sous-vers n’est par exemple plus aussi nette qu’au siècle précédent) car elle se trouve comme recouverte par l’application des autres principes.
Travaillant sur un corpus de chansons de la première moitié du xvie siècle, Ouvrard y a noté des cas d’« enjambement musical » où la ligne rythmique ne marque pas d’arrêt à la rime mais se calque sur un syntagme qui la traverse, procédé qu’il qualifie de lecture syntaxique. Seulement, pour la période qu’il étudie, il ne s’agit encore que de cas isolés relevant plus de la rhétorique que de la mécanique propre du lien texte-musique. En fait, il faut attendre les années 1570 et l’Académie de poésie et de musique fondée par Baïf pour que les musiciens, qu’ils appartiennent formellement à l’Académie comme Claude Le Jeune ou qu’ils se situent seulement dans ce qu’on peut appeler la « mouvance para-académique », commencent à mettre en évidence de manière sensible et régulière les syllabes porteuses d’un accent tonique, et donc aussi bien des syllabes masculines de fin de syntagme (principe 2 de Bacilly) que des pénultièmes de mots féminins (principe 3). On peut dès lors parler de lecture prosodique (Footnote: Pour un explicitation détaillée des termes de lecture métrique et prosodique, une description de la méthode utilisée dans le présent travail et des résultats portant sur la période 1547-1643, voir Bettens, Chronique d’un éveil prosodique et La Musique à l’école des parolesy.), dans le cas particulier de lecture prosodique accentuelle, puisque les compositeurs se mettent, avec une certaine régularité, à privilégier des syllabes du fait qu’elles sont accentuées, l’accent tonique étant bien une propriété prosodique (au sens de la note 2) de la langue.
D’autre part, la poésie mesurée de Baïf et le traitement que lui réservera un Claude Le Jeune sont primitivement fondés sur une lecture prosodique quantitative qui privilégie les syllabes en fonction, d’une part, de leur longueur par nature, notion qui recouvre la quantité « phonologique » (principe 4) et de leur longueur par position (principe 5). Ces deux principes constituent justement l’un des « bacillismes » qu’on se propose d’étudier finement à travers la pratique des compositeurs du xviie siècle.
Enfin, la symétrie (principe 6), c’est-à-dire l’allongement, par alternance, de certaines brèves, est susceptible de se trouver dans n’importe quelle musique, même instrumentale. Dans le chant, elle n’est du reste pas conditionnée par les caractéristiques propres des syllabes sur lesquelles elle porte. C’est le second des « bacillismes » qui seront examinés en détail.
Si l’on fait maintenant abstraction de la tradition musicale pour considérer l’édifice théorique bacillien du seul point de vue de son adéquation aux paroles, on voit tout d’abord que le premier principe se fonde sur la métrique syllabique qui est consubstantielle au vers français traditionnel. Les principes 2 à 4 se fondent sur des propriétés de la langue française (syntaxe, prosodie, phonologie). Le principe 5, quant à lui, repose plutôt sur des caractéristiques formelles voire graphiques du texte : on peut douter en effet que, en tant que principe général, la quantité « par position » jouisse d’un haut degré de pertinence linguistique. Enfin, le principe 6 (symétrie) correspond chez Bacilly à un rééquilibrage de nature ornementale, autrement dit un artifice.
L’enracinement d’une théorie ne constitue pas en soi un gage de validité. Bacilly, en tout cas, n’a jamais prétendu produire une théorie générale de la prosodie de la langue française, mais plutôt une technique de lecture, ou de déclamation qui, si elle est valide, ne le sera donc que dans un contexte particulier dont il ne définit du reste pas précisément les limites. Jusqu’à quel point englobe-t-il, par exemple, le style récitatif, la diction des comédiens voire celle des orateurs laïques ou religieux ? Par ailleurs, chacun des six principes qui s’en dégagent repose comme on l’a vu sur ses propres fondements : on peut donc s’attendre à ce que leurs périmètres de validité ne se recoupent pas complètement.
Enfin, si l’on reprend les quelques vers déjà utilisés en y superposant sans la moindre hiérarchisation les résultats de l’application successive des six principes, on se rend compte que, en poussant un peu, Bacilly pourrait privilégier presque toutes les syllabes :
Ah ! quelle cruauté // de luy ravir le jour
A ce jeune Heros // tout cêde sur la Terre.
Qui croiroit qu’il fut né // seulement pour la guerre ?
Il semble être fait pour l’amour.
On craint alors de se trouver en face d’une pseudo-théorie qui autoriserait tout et permettrait donc au compositeur de justifier n’importe quelle lecture.
À l’inverse, l’examen de la pratique particulière d’un compositeur n’est pas sans poser des problèmes. Soit le même fragment, avec les syllabes qu’y a privilégiées Lully (Footnote: Lully, Armide, Acte II, scène V.) :
Ah ! quelle cruauté // de luy ravir le jour
A ce jeune Heros // tout cêde sur la Terre.
Qui croiroit qu’il fut né // seulement pour la guerre ?
Il semble être fait pour l’amour.
On pressent bien que le compositeur a fait des choix et que ceux-ci n’ont pas été laissés totalement au hasard. Mais comment savoir par exemple s’il a allongé le -ros de Heros parce qu’il est à la césure (1), parce qu’il marque la fin d’un sens (2), parce qu’il est phonologiquement long (4), parce que la syllabe est, graphiquement, fermée (5) ou encore par la vertu providentielle d’on ne sait trop quelle symétrie (6) ? Comment savoir si, de manière générale, il tend à donner à tel principe ou règle la préséance sur tel autre, s’il les applique tous ou s’il en exclut certains ?
Ces questions sans réponse montrent bien à quel point l’examen d’un cas particulier, ou d’un choix restreint de cas particuliers, est inopérant. Pour avoir une chance, en dégageant des tendances, de comprendre la manière dont s’organisent les choix des compositeurs, on ne peut faire l’économie d’un recours aux statistiques. Les résultats qui suivent (voir les annexes A et B pour des tableaux synoptiques) portent sur 16 corpus de musique vocale, échelonnés entre 1600 et 1710, qui couvrent la période de l’air de cour proprement dit, de l’air sérieux, de l’opéra et des débuts de la cantate. Ils totalisent environ 18’000 vers pour 162’000 syllabes. Seules les premières strophes, s’il y a lieu, sont considérées, soit 9200 vers pour 85’000 syllabes, dont les caractéristiques linguistiques ou graphiques sont confrontées avec le traitement musical que leur réservent les compositeurs.
Placés dans un ordre plus ou moins chronologique, les corpus examinés font apparaître (figure 1) une spectaculaire montée en importance de l’accent tonique : le contraste accentuel corrigé (Footnote: Après exclusion des syllabes métriquement contraintes, le contraste accentuel se calcule en soustrayant à la proportion (en %) de syllabes accentuées qui sont rendues par une note longue celle des syllabes inaccentuées qui sont rendues par une note longue. Si l’on veut, plus le compositeur fait « ressortir » les syllabes porteuses d’un accent tonique, plus la valeur de cet indicateur sera élevée. Il est ensuite corrigé pour annuler les effets d’une dépendance statistique partielle de la variable « syllabe accentuée » et de la variable « syllabe fermée ». On peut donc affirmer que la valeur corrigée rend compte de la volonté spécifique — consciente ou inconsciente — du compositeur de souligner l’accent tonique, volonté qui n’est « contaminée » ni par le souci de souligner le mètre, ni par une éventuelle sensibilité à la quantité « par position ». Pour plus de détails sur la manière dont sont déterminés les indicateurs, voir Bettens, Chronique d’un éveil prosodique.), dont la valeur partirait de zéro si l’on élargissait le champ à des corpus remontant aux années 1550, atteint 14 chez Guédron et frôle les 50 (sur un maximum théorique de 100) pour les corpus de cantates. Cette croissance, qui traduit le souci de plus en plus marqué des compositeurs de mettre en valeur les syllabes porteuses d’un accent tonique, autrement dit de se conformer aux principes 2 et 3 de Bacilly, est un des faits saillants de l’évolution du lien texte-musique au xviie siècle. En regard du contraste accentuel, on a indiqué la valeur, également corrigée (Footnote: Par analogie avec le constraste accentuel, le contraste positionnel se calcule en soustrayant à la proportion de syllabes (graphiquement) fermées qui sont rendues par une note longue, celle des syllabes (graphiquement) ouvertes qui sont rendues par une note longue. La valeur est ensuite corrigée pour isoler la volonté spécifique du compositeur de souligner les syllabes fermées. Les syllabes féminines sont toujours considérées comme ouvertes, même lorsqu’elles sont « fermées » par s ou nt.), du contraste positionnel qui traduit la volonté des compositeurs de mettre en valeur les syllabes fermées (principe 5). Cet indicateur assez grossier — sans égard à leur spécificité phonétique, il traite de manière globale toutes les consonnes graphiquement implosives, qu’elles se prononcent ou non — pourrait correspondre à la volonté des compositeurs de rester fidèles à certains des principes de l’Académie de Baïf. On voit que sa valeur reste très nettement positive pour une bonne partie des corpus d’airs. Il n’atteint par contre pas la barre de la significativité statistique (Footnote: Eu égard à la taille des corpus examinés, on situe, en première approximation cette limite à 5 % environ pour le contraste positionnel corrigé : des valeurs inférieures pourront être considérées comme virtuellement nulles. Cas limites : les 7,36 % du corpus Boyer, de petite taille, ne sont pas pleinement significatifs (p = 0,09) au test du khi-carré. À l’inverse, les 4,35 % d’Armide sont significatifs (p < 0,01), mais pas les 3,82 qu’on obtient si l’on isole les récitatifs de cet opéra (p = 0,18).) pour quelques autres (Chancy, Chabanceau) non plus que pour les corpus de Lully et ceux, tardifs, de cantates. On voit donc que, comme l’indique l’aspect en miroir des deux courbes, autant l’accent tonique devient avec le temps un paramètre incontournable pour les compositeurs, autant ils abandonnent, à la longue, le principe 5 de Bacilly. De mixte au départ, c’est-à-dire accentuelle et quantitative, la lecture prosodique des compositeurs, avec le temps et l’évolution stylistique, tend à devenir exclusivement accentuelle.
On cherche maintenant à comprendre plus finement comment les compositeurs traitent la quantité « par position ». Celle-ci, du fait que l’accent tonique influe de manière de plus en plus prépondérante sur le traitement des syllabes, doit être examinée séparément pour les syllabes accentuées et pour les syllabes inaccentuées, d’où sa représentation sur deux diagrammes juxtaposés (figure 2). On s’intéresse donc à cerner le traitement particulier que les compositeurs pourraient réserver à trois types de consonnes : les nasales (n et m), les liquides (l et r) et les sifflantes (s,x et z). Le traitement réservé aux syllabes fermées par chacun de ces types est comparé à la moyenne des syllabes ouvertes : une barre négative signifiera donc que les syllabes concernées sont moins mises en évidence que le commun des syllabes qui ne sont pas concernées par le principe 5 de Bacilly.
Quatre groupes de corpus ressortent de cette analyse (tableau 2) :
A. Les corpus d’airs « précoces » (ou d’airs de cour proprement dits). De Guédron à Boesset, ils témoignent d’un traitement assez homogène (Footnote: Le « mépris » de Boyer pour les liquides en syllabe accentuée est trop isolé pour être interprétable.) des consonnes implosives, qui ne semble guère conditionné par la phonétique.
B. Les corpus d’airs « tardifs » (ou d’airs sérieux) : Bacilly et Lambert en sont les représentants les plus typiques. Ils se distinguent avant tout par une mise en valeur particulièrement nette des nasales implosives, autrement dit des voyelles nasales, observée tant en syllabe accentuée qu’en syllabe inaccentuée. Même les corpus qui, comme Chancy et Chabanceau, ne sont plus, globalement, sensibles à la position privilégient encore quelque peu les nasales, le premier des deux uniquement en syllabe accentuée. Cambert, qui est l’artisan, avant Lully, d’une sorte de « pré-récitatif », se rattache aussi à ce groupe. Les liquides y sont également favorisées, mais seulement en syllabe accentuée. En syllabe inaccentuée, la présence d’un l ou d’un r implosif est par contre plutôt défavorisante. Cela signifie que, par exemple, l’r de mort aura des chances d’être allongeant alors que celui de mortel sera au mieux inopérant.
C. Les corpus d’opéras de Lully : dans l’ensemble, on n’y discerne pas de sensibilité à la position. Au contraire des corpus d’airs sérieux, ils ne mettent nullement en valeur les voyelles nasales mais, tant pour Cadmus et Hermione que pour Armide, les liquides implosives y sont favorisées en syllabe accentuée. Cette sensibilité particulière aux liquides ne suffit pas à rendre clairement significatif le contraste positionnel qui est un indicateur plus global.
D. Les corpus de cantates : qu’on les examine d’un point de vue global ou qu’on détaille par type de consonnes, on n’y discerne plus de sensibilité nette à la position.
| Sensibilité… | Airs précoces | Airs tardifs | Lully | Cantates | Théorie de Bacilly |
| … globale à la position | ++ | + | - | - | +/- |
| … à la nasalité | +/- | ++ | -- | -- | ++ |
| … aux liquides (en syllabe accentuée) | +/- | + | ++ | - | + |
C’est sans grande surprise qu’on relève que le groupe qui est le plus proche des prescriptions de Bacilly — celui-ci veut en particulier que les voyelles nasales soient « toujours longues » et que les syllabes fermées par une liquide ne soient que « pour ainsi dire demi-longues » — est bel et bien le groupe des airs sérieux, celui auquel il appartient en tant que compositeur. Au moins ne pourra-t-on pas l’accuser d’avoir produit de vaines théories sans lien avec la pratique.
Ce focus sur la quantité « par position » permet donc d’entrevoir un glissement stylistique fort remarquable : encore sous l’influence directe des théories de l’Académie, la première génération des compositeurs d’airs les applique comme mécaniquement, sur une base qu’on devine essentiellement graphique. La seconde génération réserve aux syllabes fermées un traitement nettement plus différencié et manifestement conditionné par la phonétique : sont particulièrement favorisées les voyelles nasales dont l’articulation par le chanteur semble requérir une attention et donc une durée particulières et, en syllabe accentuée, les syllabes fermées par une liquide dont on conçoit bien qu’elle puisse, si l’orateur le veut, durer un certain temps. L’opéra n’a plus aucun égard aux voyelles nasales, mais il continue, pour un temps au moins et en syllabe accentuée, à privilégier les liquides. Enfin, la cantate marque l’abandon, qu’on présume définitif, de toute sensibilité à la position.
Sur les diagrammes de la figure 2, les syllabes fermées par une sifflante ne démontrent aucune tendance nette. Faut-il en déduire que les compositeurs ne sont pas attentifs à ce type de consonnes, ou alors qu’ils pourraient réserver des traitements opposés et susceptibles de s’annuler l’un l’autre à certains sous-types de sifflantes ?
On propose de considérer quatre sous-types distincts de s, ou de sifflantes (tableau 3) :
1. S « circonflexes » : ces s sont étymologiques. Ils ont cessé de se prononcer bien avant le xviie siècle et il est vraisemblable d’admettre que leur amuïssement est à l’origine d’un allongement qui pouvait être encore distinctif dans la langue dominante du temps, en particulier dans celle de Bacilly. Ils sont pris en compte ici, qu’ils apparaissent graphiquement sous la forme d’un s ou sous la forme d’un accent circonflexe et même s’ils ne sont pas signalés ; ainsi, la première syllabe du mot brûler sera-t-elle versée dans les s « circonflexes » quelle que soit la graphie rencontrée : brusler, brûler ou, plus rare, bruler (Footnote: La quantité « phonologique », telle qu’elle ressort du principe 4 de Bacilly, s’applique au mot et à sa racine : elle est indépendante de la graphie particulière usitée dans un texte donné. On ne peut donc pas souscrire à l’analyse de Thomas Leconte, Les Textes d’« airs anciens », p. 236, selon laquelle Bacilly scripteur pourrait, en faisant usage d’un accent circonflexe (ou éventuellement aigu) viser à « gommer l’ambiguïté de la double consonne, et surtout pas à “ marquer ” une longue, bien au contraire ». Bacilly peut bien écrire « brûler » et « soûpirs » là où d’autres écrivent « brusler » et « souspirs », il n’en demeure pas moins que, dans sa théorie et probablement aussi dans sa langue, la syllabe initiale du premier mot est intrinsèquement longue alors que celle du second est intrinsèquement brève.). On retient aussi par exception quelques syllabes dont l’s n’est pas étymologique, mais est la marque d’un allongement pour lequel la phonétique historique fournit une justification plausible : chaisne,empescher (Footnote: Yves-Charles Morin, que je remercie vivement pour ses encouragements et ses nombreuses remarques, souligne à juste titre que ce sous-type n’est pas totalement homogène puisque les allongements vocaliques qu’il recrute ne résultent pas tous du même mécanisme phonétique. J’assume l’incohérence éventuelle de ce choix tout en relevant que les mots atypiques effectivement sélectionnés sont très peu nombreux et que leur poids statistique est faible voire négligeable, les s étymologiques amuïs étant largement prépondérants dans ce sous-type.). Par contre, on écarte les s non étymologiques de mots comme extresme ou aisle.
2. S finaux : comme leur nom l’indique, ils terminent les mots auxquels ils appartiennent et leur statut phonétique peut varier selon le contexte : dans la diction des vers, ils sont, selon les conventions alors en vigueur, prononcés devant voyelle et muets devant consonne. Leur statut est beaucoup plus incertain à la pause (césure ou rime) (Footnote: Voir Bettens, Consonnes finales à la pause et devant voyelle et Les consonnes finales.). Ils peuvent aussi être la trace d’oppositions phonologiques de longueur. Pour cette étude, la syllabe à laquelle ils appartiennent n’est retenue que lorsqu’elle est fermée et donc que le mot suivant commence par une consonne (Footnote: Si l’initiale du mot subséquent est une voyelle, elle devient la consonne d’attaque de la syllabe suivante et le principe 5 ne s’applique plus. Les syllabes marquant la césure et la rime sont de toute façon exclues du calcul des indicateurs prosodiques, car métriquement contraintes.). On ne fait bien sûr aucune différence, en finale, entre les graphies s, z et x.
3. S prononcés : ce sont les s à proprement parler implosifs, ceux qui, à l’intérieur des mots, sont pleinement prononcés. L’usage n’ayant, sur ce point, plus beaucoup varié depuis le xviie siècle, on prend comme référence le français standard moderne.
4. S « douteux » : par élimination, on y range des s non prononcés dont le caractère allongeant n’est pas avéré, soit qu’ils ne soient pas étymologiques, soit qu’ils figurent en frontière de morphème (tousjours, préfixes es-, des-, sous-). Lorsque la graphie moderne en a gardé une trace, c’est souvent sous la forme d’un accent aigu et non d’un circonflexe.
|
Syllabe accentuée |
Syllabe inaccentuée |
|
|
S « circonflexe » |
Feste, tost, il est, brusle |
bruslé, gousté, fasché |
|
S final |
tous, loix, filz |
mes, ces, vous |
|
S prononcé |
reste, triste, peste |
resté, risqué, pester |
|
S « douteux » |
extresme, aisle |
estoit, mespris, despit, desjà |
Les syllabes fermées par les trois premiers de ces sous-types de sifflantes vont maintenant pouvoir être comparées, comme ci-dessus, au commun des syllabes ouvertes (figure 3 et tableau 4) :
A. Dans les airs « précoces », ce sont surtout les s finaux qui se détachent, aussi bien en syllabe accentuée qu’en syllabe inaccentuée. Cela pourrait, comme il en est pour les autres implosives, traduire une adhésion docile à des règles graphiques héritées de l’Académie. Ni la présence d’un allongement phonologique à l’intérieur du mot, ni celle d’un s prononcé ne paraît influencer les compositeurs.
B. Dans les airs « tardifs », les s finaux restent dans une certaine mesure en évidence, mais uniquement en syllabe inaccentuée, ce qui correspond en grande partie aux monosyllabes clitiques comme mes, les, ces, nos etc. Mais le fait le plus saillant est, en syllabe accentuée, la mise en évidence de s prononcé et, en syllabe inaccentuée, celle de s « circonflexe » (seul Chabanceau reste insensible à quelque s que ce soit). Dans le premier cas, on trouve avant tout des pénultièmes de mots féminins (reste, triste) ; dans le second, des s prétoniques (vestu, fascheux) et des pénultièmes de clitiques féminins (vostre).
C. Lully, comme il l’était pour les liquides, est quelque peu sensible aux s prononcés en syllabe accentuée : cela apparaît en tout cas dans les ballets de cour et Armide. Il ne fait montre d’aucune sensibilité à la longueur phonologique que traduisent les s « circonflexes ».
D. Les cantates, comme c’était le cas pour les autres implosives, ont abandonné toute sensibilité spécifique aux sifflantes. On note toutefois chez Bernier une légère mise en évidence de s « circonflexe » en syllabe inaccentuée.
| En syllabe accentuée | Airs précoces | Airs tardifs | Lully | Cantates | Théorie de Bacilly |
| S final | ++ | - | - | - | ++ |
| S « circonflexe » | - | - | - | - | +/- |
| S prononcé | - | ++ | +→++ | - | +/- |
| En syllabe Inaccentuée |
|
|
|
|
|
| S final | ++ | ++ | - | - | ++ |
| S « circonflexe » | - | ++ | - | +/- | ++ |
| S prononcé | - | - | - | - | +/- |
Ici aussi, la théorie de Bacilly s’avère relativement proche du corpus d’airs « tardifs », si l’on tient compte du fait qu’elle ne peut bien sûr pas faire explicitement la différence entre une syllabe accentuée et une syllabe inaccentuée.
Même si certains spécialistes peinent encore à l’admettre (Footnote: Pour un résumé des arguments pro et contra d’une controverse encore toute fraîche, voir Morin, On the phonetics of rhymes.), la langue française a bel et bien connu des oppositions de quantité qui ont touché les syllabes inaccentuées comme les syllabes accentuées. On sait que, dès le xvie siècle, de nombreux grammairiens (Footnote: Thurot II, p. 561 et sq.) décrivent la présence de syllabes longues en français et citent parfois même des paires minimales (jeune : jeusne, matin : mastin, pecher : pescher (Footnote: Henri Estienne, Hypomneses, p. 75.)) dont, selon leurs propres dires, les termes ne se distinguent que par la longueur d’une de leurs syllabes. De plus, la longueur phonologique est une composante fondamentale du système prosodique de Baïf (Footnote: Morin, La Prononciation et la prosodie du français du xvie siècle.) ; Bacilly la reconnaît également dans son traité théorique (principe 4) même si, comme il le remarque, elle tend à s’effacer dans les pénultièmes des mots féminins : entre cruelle et mesle, entre merite et viste, explique-t-il, l’opposition de longueur, présente en théorie, est neutralisée par la règle (principe 3) qui fait que toutes les pénultièmes de mots féminins apparaissent également longues du moment qu’elles sont déclamées.
Restait à savoir si les compositeurs sont influencés par cette longueur phonologique lorsqu’ils mettent un texte en musique. Pour ce qui est des compositeurs d’airs « précoces », il est difficile de trancher : en effet, ceux-ci appliquent de manière assez homogène des règles conditionnées par la graphie et il est difficile de mettre en évidence, par exemple, un traitement différencié des s « circonflexes » et des s prononcés. Par contre, comme on l’a vu, les compositeurs du groupe des airs « tardifs », qui gravitent autour de Lambert, mettent très nettement en valeur les syllabes dont la longueur résulte de l’amuïssement d’un s, mais seulement lorsqu’elles sont inaccentuées, ce qui va dans le même sens que Bacilly théoricien décrivant une interférence entre les principes 3 et 4.
Pour au moins l’un des cas où le français médiéval avait développé des oppositions de longueur — l’amuïssement des s implosifs — il est clair que, vers la fin du xviie siècle, cette longueur est prise en compte par les compositeurs d’airs. Qu’en est-il des autres cas connus d’allongements vocaliques en français ? La question pourrait être difficile à trancher car ceux-ci sont bien moins productifs que l’amuïssement des s. Il pourrait donc s’avérer délicat, compte-tenu de la taille des corpus, de recenser suffisamment d’occurrences pour que des statistiques valables puissent en être tirées.
Le cas de la vélarisation des l implosifs, relativement productif lui aussi, mérite toutefois d’être exploré. Lorsque, en roman, la consonne l se trouvait en fin de syllabe, elle avait tendance à se vélariser devant la consonne suivante, c’est-à-dire à prendre un son tendant vers la voyelle [u] qui s’est finalement combiné avec la voyelle précédente pour donner une diphtongue, laquelle s’est, au plus tard dans le courant du xvie siècle, transformée en une voyelle simple mais longue. Ainsi altare donne-t-il autel dont la première syllabe a longtemps gardé, sous la forme d’un allongement, le souvenir du l roman. Par opposition, la première syllabe du mot automne, forgé sur autumnus dans lequel on ne trouve pas trace d’un l implosif, devrait être brève. Une opposition du même type se dégage de la paire douceur (de dulcore(m) donc première syllabe longue) : douleur (de dolore(m) donc première syllabe brève puisque l’l n’est pas implosif mais initie la syllabe suivante). En utilisant des critères étymologiques, on peut assez aisément, lorsqu’on rencontre, à l’intérieur d’un mot, une graphie du type voyelle + u + consonne, déterminer si elle dérive d’un l implosif vélarisé (tableau 5). On cherche ensuite à savoir comment les compositeurs ont traité ces syllabes théoriquement longues, ainsi que celles où les mêmes graphies ne proviennent pas de l, et qui sont donc théoriquement brèves (Footnote: Comme me le rappelle Yves-Charles Morin, un mot comme « heureux » prête à hésitation car sa première syllabe, quoique ne résultant pas de la vélarisation d’un l, pourrait, puisqu’il résulte de la réduction d’un hiatus, être le siège d’un allongement d’une autre nature. On relèvera toutefois que cet allongement particulier n’est attesté ni par Bacilly ni par Baïf et que les graphies usuelles ne fournissent aucun indice qui permettrait de trancher dans un sens ou dans un autre. Je le maintiens dans le sous-type « bref » et j’assume une fois de plus l’éventuelle incohérence de mon choix, en relevant que son poids statistique est très faible.).
|
Voyelle + u + consonne … |
Syllabe accentuée |
Syllabe inaccentuée |
|
… provenant de l implosif : sous-type « long » |
autre, beaux, fausse, faut, douce, écoute, veut |
aucun, autant, autrefois, aux, beauté, heureux, douceur, souci |
|
… ne provenant pas de l implosif : sous-type « bref » |
pauvre, bonheur, jeune, souffre, trouve |
audace, causé, sçauroit, amoureux, couvrir, soupir, seulement |
En fait, les seules syllabes pour lesquelles les statistiques dégagent des tendances sont les syllabes inaccentuées (comme c’était le cas pour le sous-type des s « circonflexes ») et ouvertes. En syllabe accentuée ou fermée, les résultats sont non significatifs voire incohérents, ou alors l’effectif est trop faible pour qu’on puisse statuer. Dans la figure 4, les sous-types « long » et « bref » sont comparés au restant des syllabes à la fois inaccentuées et ouvertes (y compris la totalité des syllabes féminines). On voit immédiatement que, chez la majorité des compositeurs d’airs, le sous-type « long » est favorisé alors que le sous-type « bref » est défavorisé. La différence de traitement n’est pas pleinement significative dans les trois premiers corpus (Guédron, Boyer, Moulinié), mais elle l’est déjà chez Boesset. Elle le demeure ensuite pour tous les corpus d’airs « tardifs », à l’exception d’Ambruis. Alors qu’elle l’est encore pour les récits de ballets auxquels a contribué Lully, elle disparaît par contre aussi bien dans les opéras de Lully que dans le « pré-récitatif » de Cambert. Les cantates du début du xviiie siècle ne font aucune distinction entre les deux sous-types. On se trouve donc une fois de plus dans une situation où une tradition remontant à la Renaissance et perpétuée par les compositeurs d’airs est abandonnée par le style nouveau qui germe dans les années 1670 autour de l’opéra.
Ce résultat doit toutefois être assorti d’une réserve : il n’est pas certain que la différence observée s’établisse directement sur une sensibilité phonologique des compositeurs concernés. En effet, comme le digramme au est très fortement surreprésenté dans le sous-type long et que le digramme ou est, lui, surreprésenté dans le sous-type bref, les différences mesurées pourraient résulter de l’application d’une consigne apprise selon laquelle il siérait de favoriser diffusément la graphie au au détriment de la graphie ou et ce, sans égard particulier à l’étymologie (Footnote: Bacilly théoricien, L’Art de bien chanter p. 413-414, semble bien faire la différence entre des au longs, presque tous étymologiques et des au brefs; par contre, il considère les ou de douceur et de douleur comme également brefs.). La taille des corpus en présence ne permet malheureusement pas de dissiper ce doute : il y a trop peu d’occurrences pour qu’on puisse, digramme par digramme, rechercher des oppositions de longueur plus spécifiques.
La pratique du groupe de compositeurs d’airs « tardifs » ou sérieux, dominé par les statures de Lambert et de Bacilly, représente un instant tout à fait remarquable dans l’histoire du lien texte-musique. On est à la veille d’un basculement qui marquera le triomphe définitif de l’accent tonique comme principe unique de mise en musique d’un texte. Se voulant avant tout concret et efficace, tout comme doivent l’être les machines de l’opéra (n’annoncent-elles pas déjà celles de l’industrialisation ?), le style récitatif refusera de s’encombrer de subtilités qui remontent à la Renaissance. Arc-boutés contre cette révolution déjà en marche, les compositeurs d’airs persistent dans une alchimie dont le maître mot n’est pas l’efficacité mais plutôt la minutie et dont les multiples tours de main se transmettent de maître à disciple.
Comment comprendre alors la manière dont s’y articulent les principes 2, 3, 4 et 5 de Bacilly pour aboutir aux résultats qui viennent d’être présentés ? Pourquoi, en particulier, certaines caractéristiques ne sont-elles mises en évidence qu’en syllabe accentuée alors que d’autres ne le sont qu’en syllabe inaccentuée ? Un essai de hiérarchisation peut être maintenant proposé, sur la base des observations suivantes :
Qu’elle soit liquide ou sifflante, une consonne implosive prononcée (principe 5) n’aura des chances d’être prise en compte par le compositeur que si la syllabe concernée a été préalablement privilégiée. Ainsi, si la syllabe (et donc la voyelle) a déjà été sélectionnée en tant que porteuse d’un accent tonique (principes 2 et 3), la présence supplémentaire d’une consonne implosive augmentera la probabilité que le compositeur la rende par une note longue.
Un allongement phonologique ou une consonne finale non prononcée seront pris en compte dans les syllabes qui n’ont pas été préalablement privilégiées (échappant aux principes 2 et 3), mais ils auront toutes les chances d’être négligés lorsque la syllabe est accentuée (et donc déjà privilégiée par les principes 2 et 3), comme si la voyelle ne pouvait pas être rendue « encore plus longue » qu’elle ne l’est déjà.
Il y aurait donc, dans le projet conscient ou inconscient des compositeurs de ce groupe, une sorte de hiérarchie voyelle-consonne : en syllabe inaccentuée (voyelle non privilégiée), les privilèges de nature vocalique seraient les seuls a recevoir une traduction musicale. En syllabe accentuée (voyelle déjà privilégiée), ceux-ci deviendraient inutiles et ce seraient les privilèges portant sur les consonnes qui prendraient le relais pour déployer leurs effets en musique.
Dans cette idée, on comprendrait que les voyelles nasales puissent jouer sur les deux tableaux, et donc être favorisées aussi bien en syllabe accentuée qu’en syllabe inaccentuée. En effet, selon la prononciation qu’on leur réserve, elles peuvent être entendues aussi bien comme des voyelles « modifiées » (ce qui justifierait qu’elles soient mises en évidence en syllabe inaccentuée) que comme des voyelles « normales » suivies d’un vestige consonantique (ce qui justifierait qu’elles ressortent en syllabe accentuée).
Dernier, dans l’ordre, à être appliqué par Bacilly, le principe de symétrie est aussi le plus superficiel : autonome par rapport à la langue aussi bien que par rapport au texte, il a la valeur d’un rééquilibrage de fin de course, à fonction essentiellement esthétique.
À première vue, la symétrie rappelle l’inégalité, emblématique de la musique française. Mais l’analogie a ses limites (figure 5). L’inégalité consiste en effet à mettre légèrement en évidence une brève sur deux, qui devient alors un peu moins brève que la brève qui la suit, mais demeure, essentiellement et tout comme sa voisine, une brève. Rarement écrite, l’inégalité est plus un tour d’interprète qu’un fait de compositeur. Dans la symétrie, au contraire, une brève sur deux, loin de se contenter d’un simple allongement accidentel, devient substantiellement longue et même si, une fois transformée, elle n’est pas tout à fait aussi longue que les plus longues des longues, il faut néanmoins considérer qu’elle a changé de nature. Contrairement à l’inégalité, la symétrie est très souvent écrite : c’est donc en bonne partie un fait de compositeur et l’on peut s’attendre à en trouver des traces dans les corpus examinés ici.


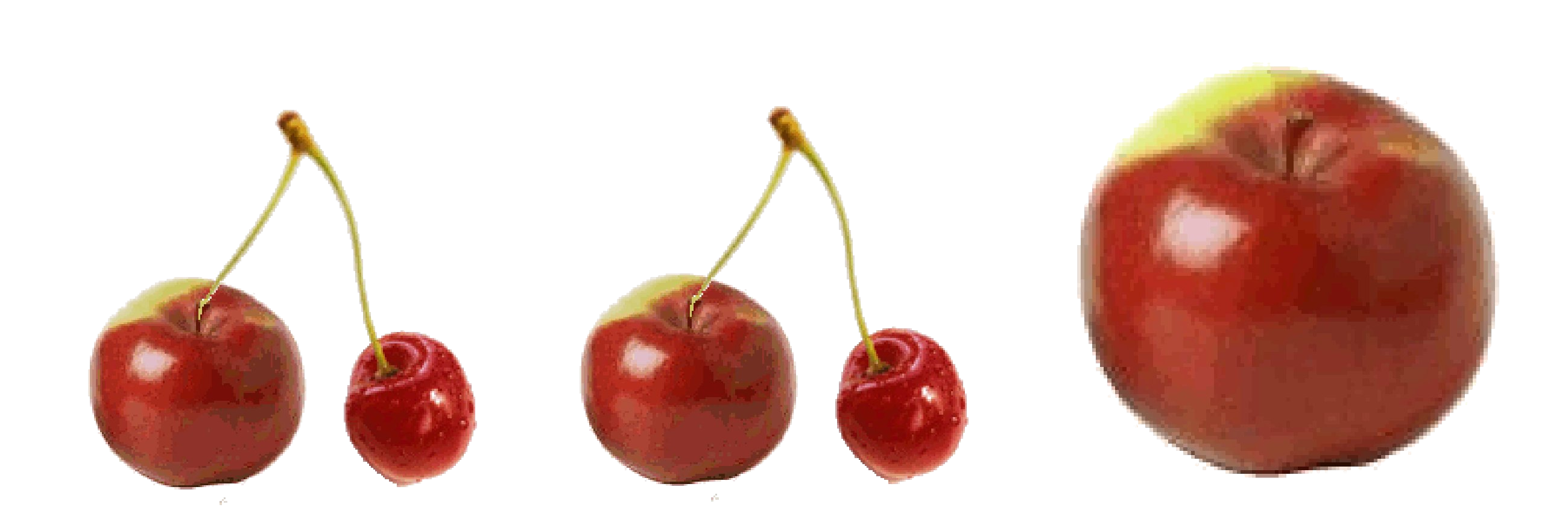
La nuance n’est pas sans conséquence : toute allongée qu’elle puisse être en pratique, la plus « forte » de deux brèves inégales ne se prêtera guère aux agréments qui sont les attributs des longues ; une brève rendue longue par symétrie, par contre, pourra être le siège de tous les passages et tremblements qu’on voudra, au même titre que n’importe quelle longue. Et comme le rôle de l’ornementation est capital dans l’interprétation des airs du cviie siècle, on comprend bien que plus on fera jouer la symétrie, plus on produira des longues sur lesquelles le chanteur pourra démontrer son agilité.
Toute symétrie repose donc sur des points d’ancrage qui sont des syllabes ayant, en vertu d’un des principes 1 à 5, déjà été privilégiées. Après avoir choisi ces syllabes d’ancrage, il est possible de calculer un indice de symétrie qui mesure à quel point les syllabes intermédiaires se conforment à une alternance régulière de notes longues et brèves (Footnote: Si toutes les syllabe intermédiaire se conforment à la symétrie, l’indice sera de 100, il sera de 0 si le compositeur n’a observé aucune symétrie et de -100 si toutes les syllabes intermédiaires se conforment à la symétrie inverse (brève-longue au lieu de longue-bréve).). La figure 6 montre trois courbes superposées correspondant, pour chacun des 16 corpus, au calcul de l’indice de symétrie en prenant successivement comme points d’ancrage les syllabes métriquement contraintes (principe 1), en ajoutant les syllabes accentuées (principes 1 à 3) et, finalement, les syllabes longues par position (principes 1 à 5). Plus les règles appliquées par le compositeur sont proches de celles de Bacilly, et plus on s’attend à ce que la troisième courbe, celle qui prend en compte la totalité des principes donne le résultat maximal. Ce n’est probablement pas un hasard si ce cas de figure ne se retrouve que chez Guédron, Boesset, Bacilly et Lambert, qui sont les piliers de la grande tradition de l’air de cour.
Si l’on confronte maintenant (figure 7) le contraste positionnel global, tel qu’il ressort de la figure 1, avec, pour chaque corpus, l’indice de symétrie maximal, c’est-à-dire le point le plus élevé des trois courbes de la figure 6, on constate que les deux corpus qui recourent le plus systématiquement au principe de symétrie pour générer des longues sont Chancy et Chabanceau. Or, ce sont précisément les deux seuls corpus d’airs qui ne sont pas, globalement, sensibles à la position et qui, autrement dit, n’utilisent pas le principe 5 pour produire des longues.
Cette espèce de compensation 5-6 est à elle seule tout à fait révélatrice de ce qui est une caractéristique fondamentale de l’air : il a besoin de se déployer sur un grand nombre de longues, qu’il ne peut bien sûr choisir au hasard, c’est-à-dire sans égard aux paroles, mais qu’il se doit d’équilibrer très subtilement les unes par rapport aux autres, d’où le recours à une hiérarchie complexe de principes dont il faudra arranger, accommoder les effets potentiellement contradictoires. Par opposition, le récitatif, qui vise à l’efficacité dramatique, a probablement besoin de bien moins de longues (l’ornementation n’y joue qu’un rôle restreint). Il peut donc sans l’ombre d’un scrupule se contenter du seul rythme prosaïque qui lui est dicté par les retours de l’accent tonique, en faisant table rase de principes plus subtils comme la longueur par position et la symétrie.
Le principe de symétrie (6) dépendant très peu du texte, on s’attend à ce que, plus que les autres, son application soit laissée à la discrétion du compositeur. Plus que les autres aussi, il devrait donc être discriminant en matière de style. De fait, comme le montre la figure 7, il est possible de tracer une ligne horizontale qui, sur la seule base de l’indice de symétrie va permettre de départager l’air des genres plus dramatiques (opéra, cantate) (Footnote: Les deux corpus les plus anciens (Guédron et Boyer), encore peu différenciés, doivent être exclus.). L’air peut donc être redéfini (figure 8) comme un style à haut degré de symétrie et le récitatif, par opposition, comme un style à bas degré de symétrie. Si l’on se base sur ce critère, on voit aussi que les récits de ballets auxquels contribua Lully au commencement de sa carrière (corpus « Ballets »), et dont l’indice de symétrie est assez élevé, appartiennent encore de plein droit à la classe des airs.
Moins abstrait, mais peu fondé sur la langue, le principe de quantité « par position » (5) fournit un critère secondaire au moyen duquel on pourra départager, parmi les airs, ceux appartenant au courant dominant (Boesset, Bacilly, Lambert) de productions plus en marge (Chancy, Chabanceau). Parmi les styles dramatiques, on aura, d’un côté, le travail de Cambert, qu’on peut qualifier de « pré-récitatif » et, de l’autre, le modèle créé par Lully, tel qu’il s’imposera pour la postérité.
Le principe de quantité « phonologique » (4) est fondé linguistiquement. Néanmoins, il ne porte que sur un nombre restreint de syllabes et son application est difficile à contrôler. Sur la base d’investigations partielles, on retire l’impression qu’il traduit la survivance, dans le style de l’air, de règles qui étaient centrales à la fin de la Renaissance. Abandonné par les styles dramatiques, il ne permet pas pour autant de délimiter de nouvelles sous-classes.
Enfin, aucune forme de chant n’échappe aux principes centrés sur l’accent tonique (2 et 3) et le mètre (1). Ces principes, dont on peut penser qu’ils appartiennent aux fondements de toute déclamation, ne sont pas discriminants parce qu’une musique savante qui, au xviie siècle, ne les aurait pas observés aurait été ressentie comme allant contre le texte. Une telle musique n’existe probablement pas.
La chanson de la Renaissance s’est constituée sur une lecture exclusivement métrique (principe 1) du texte poétique. Un grand avantage de cette lecture est son côté « passe-partout » : composée pour la première strophe, la musique peut sans le moindre inconvénient être répétée inchangée pour un nombre indéterminé de strophes subséquentes, pourvu que celles-ci observent le même mètre que la première : cette règle peut être formulée dans les termes usuels de l’art poétique, sans référence à la musique. Dès lors que la lecture des compositeurs devient prosodique, c’est-à-dire que, à l’instar des principes 2 à 6 de Bacilly, elle s’attache à mettre en évidence des syllabes particulières de l’énoncé qui constitue le vers et non plus seulement les syllabes remarquables du schéma métrique, le risque existe que des tensions s’installent entre la musique, conçue pour la première strophe, et le texte des strophes suivantes.
On ne sait pas comment les interprètes d’airs « précoces » ont géré ces tensions. Les airs de cette période se présentent souvent avec de nombreuses strophes, mais il n’existe que très peu de doubles écrits. Lorsqu’on examine les rares documents existants, on en ressort avec l’impression que l’ornementation a été conçue selon une logique purement musicale, et l’on n’y discerne en tout cas aucune volonté nette de « corriger » une éventuelle inadéquation de la musique au texte des strophes successives (Footnote: Cette remarque s’applique en particulier aux doubles de l’air de Boesset, N’esperez plus mes yeux, dont une version qui remonterait au compositeur lui-même a été transmise par Mersenne (L’Harmonie universelle : Traité de l’embellissement des chants, p. 411). Cet air et ses doubles ont fait l’objet d’une présentation par la regrettée Birgit Grenat dans l’atelier qui a ponctué la journée de Tours.).
Il en va tout autrement à la génération d’après. Dans son chapitre sur les passages et diminutions, Bacilly (Footnote: Bacilly, L’Art de bien chanter, p. 213. Voir, ici-même, la communication de Clémence Monnier et Mathilde Vittu, entièrement consacrée aux « seconds couplets en diminution ».), répondant à « ceux qui frondent contre la diminution », relève qu’un avantage de l’ornementation des seconds couplets est qu’on peut l’utiliser pour « remédier » aux problèmes d’adéquation texte-musique. Quatre des corpus d’airs sérieux examinés ici nous sont parvenus avec des doubles écrits. Il est donc tentant de contrôler si, globalement, ces doubles ont été composés en tenant compte de la remarque de Bacilly.
Dans les histogrammes de la figure 9, la première barre correspond aux indicateurs calculés sur les premiers couplets, la deuxième à l’application rigide de la musique au texte du second couplet, et la troisième de l’application de la musique du double orné au texte du second couplet. Comme on pouvait s’y attendre, on observe, pour la plupart des indicateurs et des corpus, une baisse de score relativement importante lorsqu’on applique telle quelle la musique au texte du second couplet, suivie d’une remontée très nette lorsque la musique du double orné lui est substitué. Autrement dit, la composition des doubles tend effectivement à « corriger » les problèmes d’adéquation musique-texte.
Parmi les indicateurs considérés, le contraste accentuel est celui qui fait le mieux apparaître ce processus de « correction » : aucun des quatre corpus n’y échappe. La correction du contraste positionnel ne ressort pas chez Chabanceau. Comme celui-ci, on l’a vu, n’est déjà pas sensible à la position dans les premiers couplets, on ne s’attend guère à ce qu’il le devienne pour les doubles. S’agissant de la mise en valeur des voyelles nasales, la plupart des corpus corrigent. La correction est particulièrement nette (Chabanceau excepté) en syllabe inaccentuée. Chez Ambruis, l’absence de correction en syllabe accentuée n’est guère interprétable (corpus peu volumineux). Enfin, la symétrie est le paramètre qui pâtit le moins de l’application rigide de la musique au second couplet. On se souvient en effet qu’une bonne partie des symétries prises en compte s’ancrent sur les syllabes métriquement contraintes qui sont bien sûr communes à tous les couplets. On attendra donc aussi moins de corrections de la part du double.
Les principes 5 (quantité « par posistion ») et 6 (symétrie) apparaissent donc comme des « bacillismes ». Peu fondés du point de vue de la langue, ils restent sur le bord du chemin au moment où naissent l’opéra et le récitatif. Si leur périmètre de validité n’est pas limité au seul Bacilly, il se restreint néanmoins à une lignée de compositeurs d’airs qui le précèdent et l’environnent, lignée qui s’éteindra avec Lambert et lui. Dans les années 1670-80, ces « bacillismes » font probablement figure de mignardises un peu désuètes réservées aux chanteurs d’airs. Artificiels et donc absents du discours naturel ou spontané, ils sont stylistiquement trop connotés pour qu’on s’attende à les trouver dans le discours soutenu des orateurs ou des comédiens, nonobstant la part d’artifice que celui-ci comporte.
Ces considérations sur le lien texte-musique amènent à s’interroger sur le périmètre de validité d’un autre groupe de remarques, celles qui constituent la deuxième partie de l’Art de bien chanter, et qui portent sur la prononciation proprement dite. Bacilly s’appuie beaucoup sur les grammairiens, mais il donne aussi des règles qui, selon lui, leur ont échappé parce qu’elles ne sont pas « de leur ressort » (Footnote: Bacilly, L’Art de bien chanter, p. 248.). Ce sont ces règles-là qu’il est important d’identifier car elles pourraient fort bien être des « bacillismes » phonétiques, c’est-à-dire des traits à l’usage exclusif des chanteurs d’airs.
Son traitement des voyelles nasales vient immédiatement à l’esprit. Bacilly décrit par exemple une prononciation du a nasal que, selon le point de vue adopté, on peut qualifier d’archaïque ou de méridionale :
il ne faut pas prononcer l’n d’abord, mais lors qu’on est prest de finir la Notte longue ; et s’il y a plusieurs Nottes […] il ne faut prononcer l’n, que lors que l’on est prest de finir, autrement ce seroit Chanter du nez ; […] Nota , que quand ie dis qu’il ne faut prononcer l’n qu’à la fin de la Cadence du Port de Voix & autres semblables, ie ne veux pas dire frapper, mais seulement effleurer. (Footnote: Bacilly, L’Art de bien chanter, p. 261-262.)
Ce n’est pas la précision du témoignage qui est ici en question — on souhaiterait pouvoir lire plus souvent d’aussi bonnes descriptions sous la plume des grammairiens — mais bien le périmètre de validité de cette remarque. En effet, il apparaît clairement que, au moment où Bacilly écrit, l’usage dominant (autrement dit, le « bon usage ») avait déjà tranché en faveur de la prononciation que nous connaissons aujourd’hui en français septentrional, à savoir une nasalisation complète de la voyelle avec absence de vestige consonantique. Les grammairiens de la fin du siècle en témoignent d’une manière difficilement contestable (Dangeau, Hindret, Vaudelin et probablement déjà Chifflet dès 1659 (Footnote: Thurot II, p. 421 et sq. Voir aussi la communication de Jean-Noël Laurenti à la journée Bacilly de Tours, 2008.)), mais c’est peut-être encore Bacilly lui-même qui en fournit la preuve la plus convaincante : se donnerait-il tant de peine pour décrire la prononciation qu’il réclame et pour mettre ses élèves en garde contre le « chant du nez » (c’est-à-dire la nasalisation complète) s’il s’attendait à ce que ceux-ci adoptent spontanément la prononciation archaïque ? Non, bien sûr : il est à peu près certain qu’il s’adresse à un élève type qui, dans son parler spontané, a déjà adopté la prononciation de Dangeau.
Pourquoi, dans ce cas, Bacilly reste-t-il attaché à la prononciation archaïque ? Pour des raisons ayant trait à la technique et à l’esthétique vocales — on peut le penser — mais probablement aussi par simple tradition : bien qu’il n’existe pas de document incontestable, on peut postuler que, au moment où prend corps la tradition de l’air de cour, soit à l’aube du xviie siècle, l’usage dominant à la Cour et dans l’aristocratie ait encore penché pour la prononciation archaïque. De naturelle au départ, cette prononciation serait donc, en restant figée dans la bouche des chanteurs malgré l’évolution de l’usage, devenue artificielle et stylistiquement connotée. Mais comment savoir alors si, du temps de Bacilly, la prononciation archaïque ne persistait plus que dans l’univers précieux et un peu confiné de l’air sérieux, ou si elle avait encore sa place dans tout ou partie du spectre très large de ce que Grimarest (Footnote: Grimarest, Traité du récitatif.) appelle le « récitatif » et qui englobe en fait tout discours public, y compris le récitatif de l’opéra ?
L’attitude de Lully face aux voyelles nasales est à cet égard très éclairante : alors que Bacilly ne cesse de répéter que la nasalité est un facteur allongeant et que la quasi-totalité des compositeurs d’airs s’ingénient en effet à favoriser ces voyelles en les rendant par des notes longues, Lully, dans ses récitatifs, rompt complètement avec cette pratique en réservant aux syllabes en question le même traitement qu’à n’importe quelle syllabe ouverte. Aurait-il pu se permettre une telle entorse si son modèle parlé — la déclamation tragique des comédiens — avait connu la prononciation artificielle « en deux temps » (et donc certainement exigeante en terme de durée) de Bacilly et de l’air sérieux ? On gagera que non. Sur cette base, on peut fort bien imaginer, déjà sous Lully, un chanteur qui, lorsqu’il récite en passant rapidement sur les syllabes, produit des voyelles nasales « modernes » et qui, en revanche, réserve la prononciation « archaïque » aux quelques cas où il doit développer une longue note avec passages et tremblements.
Les voyelles nasales sont un vrai cas d’école : des pratiques ayant trait au lien texte-musique et qu’il est donc possible de débusquer chez les compositeurs fournissent des indices qui, de manière indirecte, renseignent sur ce qu’aurait pu être la phonétique spécifique d’un style donné. L’enseignement qui, raisonnablement, devrait en être tiré est que le témoignage de Bacilly, d’une qualité exceptionnelle s’agissant du chant de l’air, ne peut être étendu sans de sévères précautions aux autres formes de chant et de discours. Dans les cas où Bacilly se trouve isolé face aux grammairiens de son temps, ou en tout cas aux plus importants d’entre eux, on devrait, jusqu’à preuve du contraire, considérer qu’on à affaire à un « bacillisme », autrement dit à un trait qui a sa place dans la grande tradition de l’air de cour mais pas dans le style récitatif et encore moins, bien sûr, dans les formes parlées de déclamation.
Comme autres « bacillismes » potentiels, on évoque la prononciation, à la pause, des consonnes finales et en particulier des marques de pluriel ainsi que la prononciation des e féminins « à peu pres comme la Voyelle composée eu » (Footnote: Bacilly, L’Art de bien chanter, p. 266, 312 et sq.).
Pierre de Nyert fut le maître de Bacilly et de Lambert, et leur trait d’union avec le « vieux Boesset ». Lorsque, le prenant à témoin, La Fontaine (Footnote: Jean de La Fontaine, Épître XII. Sur l’Opéra, à M. de Nyert, Oeuvres complètes, p. 542-545.) déplore que la chanteuse Hilaire Dupuis, belle-soeur de Lambert longtemps adulée par le public, soit désormais passée de mode, il rend compte à sa manière du changement de paradigme dont il a été question ici.
Quelles que soient les raisons qui pouvaient l’amener, vers la fin des années 70, à en vouloir personnellement à Lully (Footnote: Une tentative de collaboration des deux hommes, autour de l’opéra Daphné, s’était terminée en queue de poisson.), il reprend, dans cette épître, les objections les plus fondamentales que pouvait alors susciter l’opéra en tant que genre émergent. Au lieu de l’alexandrin figurant en exergue du présent article, il aurait tout aussi bien pu écrire :
*Le bon chanteur jamais ne devroit réciter.
Dans un monde parfaitement réglé où, de toute éternité, les chanteurs chantent, les danseurs dansent et les comédiens jouent la comédie, promouvoir une forme de spectacle où les comédiens se mettent à chanter, les chanteurs à jouer et les machines à s’enrayer, c’est courir le risque de passer pour un apprenti sorcier.
L’opéra est-il un mirage inaccessible, un art possible parmi d’autres, ou alors le parangon de tous les arts du spectacle ? Ce grand débat esthétique, jamais tranché, se répercute jusqu’à nos jours dans la représentation qu’on se fait du lien texte-musique. En analysant de ce point de vue des airs de cour du xviie siècle, le grand historien du vers français qu’est Georges Lote (Footnote: Lote, Histoire du vers, IV, p. 134-5.) n’y trouve que des « maladresses » et des « fautes » : seul le récitatif de Lully, à la « rythmique si nette et si lumineuse », trouve grâce à ses yeux. C’est tout simplement parce que s’impose à lui, comme seule référence possible, le paradigme de l’opéra, plus exactement du récitatif, dans lequel le compositeur se doit d’imiter ou, mieux, de styliser d’une manière très concrète ce qu’un comédien aurait fait de son texte. Lote ne voit pas que cette contrainte, à laquelle il voudrait soumettre rétroactivement toute la musique vocale, loin de traduire une loi universelle, n’est qu’une des façons possibles de mettre un texte en musique. De Machaut à Lambert, la tradition lyrique française se comporte au contraire comme un système autonome dont le modèle n’est pas l’orateur qui parle mais bien le chanteur qui chante ! Ce système n’en reste pas moins, à sa manière, très intimement calqué sur le texte poétique ; seulement, les lectures diverses et changeantes auxquelles il le soumet sont considérablement plus abstraites.
Au cours de son histoire, le lien texte-musique connaît en France au moins deux changements majeurs de paradigme. Le premier intervient dans les années 1570, au moment où, sous l’influence des théories de l’Académie de poésie et de musique, la lecture des compositeurs, de simplement métrique qu’elle était à l’origine, devient prosodique ou plutôt mixte. Ce paradigme « mixte » reste partiellement fondé sur le mètre syllabique, mais il comprend surtout une lecture quantitative qui s’efforce d’appliquer, quoique de manière non systématique, certaines des règles inspirées par la prosodie gréco-latine ; il fait preuve en plus d’une sensibilité croissante à l’accent tonique, avec en prime une bonne dose de symétrie. C’est, si l’on veut, le « paradigme des compromis », dont on trouve l’aboutissement le plus alambiqué dans la théorie de Bacilly et les airs de Lambert. Le second changement majeur est justement celui qui voit naître l’opéra : le nouveau style récitatif marque le retour à la simplicité en mettant en avant un paradigme qui est, lui, presque exclusivement accentuel. Pour s’imposer, ce dernier n’aura du reste eu besoin de s’appuyer sur aucune théorie, comme si son caractère pour ainsi dire « photographique » lui fournissait une justification suffisante.
Il n’existe aucune raison de penser que la déclamation parlée ait été agitée par les mêmes turbulences que le lien texte-musique. La soi-disant « déclamation circonflexe », qui pourrait faire figure de pendant parlé à la lecture métrique des musiciens, est une pure invention de Lote (Footnote: Lote, Histoire du vers, IV, p. 222 et sq. Lote a besoin de créer cette chimère à partir des exemples de lecture métrique qu’il trouve en musique, pour la seule raison qu’il ne peut imaginer qu’une déclamation musicale ne soit pas l’imitation précise et concrète d’une déclamation parlée.), à l’appui de laquelle personne n’a jamais fourni le moindre indice historiquement crédible. Le paradigme « quantitatif », quant à lui, a pu se rencontrer ponctuellement lorsqu’il s’est agi de réciter des vers mesurés à l’antique. Dans le domaine parlé, il représente tout au plus un courant limité dans le temps et stylistiquement circonscrit, qui n’a en rien eu l’influence déterminante qu’on lui connaît en musique. C’est donc bel et bien un paradigme très proche de celui du récitatif en musique qui définit, indépendamment de la période considérée, la déclamation parlée du français : associant, parfois jusqu’à la tension, une adéquation étroite au mètre avec un assujettissement à la syntaxe et à l’accent tonique, il correspond en gros à ce qui reste de la théorie bacillienne lorsqu’on l’a dépouillée de ses « bacillismes » et qu’on n’en garde donc que les trois (ou quatre) premiers principes. Présent depuis la nuit des temps dans l’univers de l’orateur, ce paradigme n’attendait, pour faire son entrée en musique, que l’avènement d’un jeune loup (Footnote: « Il ressemble à ces loups qu’on nourrit… ». Il ne s’agit là que du plus amical des qualificatifs dont La Fontaine gratifie Lully : Le Florentin, Satire précédent l’épître XIV, Oeuvres complètes, p. 547-548.) florentin, bien décidé à ne faire qu’une bouchée du malheureux Bacilly et de son propre beau-père.
Communication prononcée à la « Journée Bacilly » organisée par Jean-Noël Laurenti et le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance. Tours, le 28 novembre 2008.
Nom : Chaque corpus est désigné par un nom abrégé, qui permet de l’identifier facilement.
Datation : Une année de référence, approximative et strictement indicative, est assignée à chaque corpus. Elle correspond, en principe, à la date d’édition de la source qui a servi à la saisie. Lorsque plusieurs sources ont été utilisées, une année intermédiaire est proposée.
|
Guédron : 1610 159 airs puisés en majorité dans les livres d’Airs de différents Autheurs édités par Gabriel Bataille et imprimés par Ballard entre 1608 et 1632. S’y ajoutent les airs polyphoniques édités par Royster dans sa thèse (1973) ainsi que quelques airs mis à disposition par Georgie Durosoir (édition en préparation). |
|
Boyer : 1619 37 airs du Premier livre d’Airs à quatre parties, Ballard, Paris, 1619, d’après l’édition de Thomas Leconte, Centre de Musique Baroque de Versailles. |
|
Moulinié : 1629 114 airs des Cinq livres d’Airs avec la tablature de luth, Ballard, Paris, 1624, 1625, 1629, 1633, 1635. |
|
Boesset : 1633 173 airs puisés en majorité dans les recueil de Gabriel Bataille (cf. Guédron), auxquels s’ajoutent quelques airs tirés des anthologies Durosoir (Mardaga) et Verchaly (Heugel), et quelques autres mis à disposition par Thomas Leconte (édition en préparation). |
|
Chancy : 1644 25 airs du Second livre d’airs de cour, Paris 1644. Editions du Centre de Musique Baroque de Versailles. |
|
(Lully-)Ballets : 1655 78 pièces extraites des ballets de cours auxquels contribua Lully, depuis le Ballet des Plaisirs, jusqu’au Ballet de Flore. Manuscrit Philidor. |
|
Cambert : 1670 Fragments conservés de Pomone et des Peines et Les Plaisirs de l’Amour. Ballard, 1671 et 1672. |
|
(Lully-)Cadmus : 1673 Intégralité de l’opéra Cadmus et Hermione, édition Prunières. |
|
Bacilly : 1668 147 airs des Trois Livres d’Airs Regravez, 1668, du Troisieme Livre de Chansons pour danser et pour boire, 1665 et des deux livres d’Airs Sprirituels, 1688. |
|
Chabanceau : 1669 17 Airs à deux parties, Ballard, 1669 |
|
Le Camus : 1671 32 Airs à deux et trois parties, édités par Robert A. Green. Pour les textes (graphie modernisée dans cette édition), la base Philidor a été utilisée. |
|
Lambert : 1680 75 airs extrait des Airs de Monsieur Lambert non imprimez. |
|
Ambruis : 1685 25 airs du Livre d’Airs avec les seconds couplets en diminution, 1685. |
|
(Lully-)Armide : 1686 Intégralité de l’opéra Armide, Ballard, 1686. |
|
Bernier : 1705 Troisième, sixième et septième livres de cantates, Paris, 1703-1723. |
|
Batistin : 1710 Jean-Baptiste Stuck, Cantates, livres I à IV, Paris, 1706-1714. |
Ce tableau regroupe les données ayant servi pour l’établissement de la plupart des diagrammes (à l’exception de la figure 9). Les valeurs en gras indiquent un contraste statistiquement significatif. La répartition des corpus en quatre groupes a été définie plus haut)
|
|
Guédron
|
Boyer
|
Moulinié
|
Boesset
|
Chancy
|
Lully ballets
|
Cambert
|
Cadmus
|
Bacilly
|
Chabanceau
|
Le Camus
|
Lambert
|
Ambruis
|
Armide
|
Bernier
|
Batistin
|
|
| Année de référence | 1610 | 1619 | 1629 | 1633 | 1644 | 1655 | 1670 | 1673 | 1668 | 1669 | 1671 | 1680 | 1685 | 1686 | 1705 | 1710 | Total |
| Groupe | A | A | A | A | B | B | B | C | B | B | B | B | B | C | D | D |
|
| Nombre de pièces | 159 | 37 | 114 | 173 | 25 | 78 | 32 | 72 | 147 | 17 | 32 | 75 | 25 | 61 | 113 | 118 | 1278 |
| Nombre de vers | 4080 | 922 | 1730 | 3164 | 436 | 828 | 411 | 833 | 1702 | 202 | 254 | 682 | 386 | 765 | 953 | 895 | 18243 |
| Nombre de syllabes | 33348 | 7803 | 15473 | 27167 | 3625 | 7324 | 3727 | 7843 | 15158 | 1808 | 2507 | 6652 | 3712 | 7747 | 9508 | 8634 | 162036 |
| Nombre de vers (1e strophes) | 829 | 203 | 679 | 990 | 162 | 617 | 411 | 817 | 927 | 106 | 235 | 415 | 222 | 765 | 953 | 895 | 9226 |
| Nombre de syllabes (1e strophes) | 6807 | 1718 | 6104 | 8525 | 1349 | 5468 | 3727 | 7722 | 8543 | 959 | 2317 | 4020 | 2127 | 7747 | 9508 | 8634 | 85275 |
| Contraste accentuel (corrigé) | 14.09 | 12.12 | 24.74 | 25.61 | 31.18 | 31.30 | 29.19 | 38.66 | 28.49 | 36.47 | 30.86 | 35.96 | 41.48 | 38.27 | 47.46 | 49.14 |
|
| Contraste positionnel (corrigé) | 9.26 | 7.36 | 5.35 | 7.44 | 3.84 | 2.90 | 9.90 | 1.56 | 11.78 | 4.17 | 13.20 | 10.37 | 9.44 | 4.35 | 3.26 | -0.17 |
|
| Symétrie (valeur maximale) | 14.0 | 13.0 | 21.1 | 17.8 | 47.0 | 33.4 | 15.7 | 14.7 | 37.3 | 53.2 | 32.6 | 30.9 | 24.3 | 5.1 | 10.1 | 11.8 |
|
| Symétrie ancrée sur le mètre | 6.5 | 13.0 | 13.7 | 10.1 | 36.5 | 24.7 | 4.4 | 3.7 | 23.8 | 40.5 | 24.4 | 14.8 | 17.7 | 0.9 | 3.1 | 6.6 |
|
| Symétrie ancrée sur mètre + accent | 9.0 | 5.5 | 21.1 | 15.5 | 47.0 | 33.4 | 15.7 | 14.7 | 33.6 | 53.2 | 32.6 | 19.9 | 23.2 | 4.8 | 10.1 | 11.8 |
|
| Symétrie ancrée sur mètre + accent + position | 14.0 | 10.8 | 17.3 | 17.8 | 44.6 | 33.1 | 14.6 | 9.6 | 37.3 | 46.9 | 27.7 | 30.9 | 24.3 | 5.1 | 9.0 | 11.8 |
|
| En syllabe accentuée, mise en évidence syllabes fermées | 7.7 | 13.5 | 11.4 | 6.4 | 7.0 | 4.4 | -2.9 | 0.4 | 8.5 | 2.8 | 10.9 | 8.3 | 11.5 | 1.3 | 0.2 | -3.8 |
|
| nasales | -1.7 | 21.3 | 5.2 | 5.0 | 14.0 | 7.6 | 14.2 | -0.4 | 15.1 | 12.7 | 20.3 | 14.7 | 15.5 | 5.5 | 8.5 | 0.8 |
|
| liquides | 5.3 | -15.2 | 9.4 | 10.3 | 4.3 | 6.1 | 13.9 | 14.9 | 7.3 | 1.4 | 6.8 | 10.9 | 17.7 | 13.8 | 6.4 | 6.0 |
|
| sifflantes | 8.0 | 9.0 | 8.4 | 3.7 | 7.6 | 4.1 | -9.0 | -0.9 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | -1.5 | 1.0 | -4.4 | -0.3 |
|
| En syllabe inaccentuée, mise en évidence syllabes fermées | 11.8 | 5.2 | 2.4 | 9.5 | 3.0 | 2.6 | 18.4 | 2.6 | 16.0 | 5.6 | 17.4 | 14.3 | 10.5 | 6.6 | 5.7 | 1.7 |
|
| nasales | 15.5 | 6.3 | 5.8 | 9.6 | 0.2 | 3.4 | 25.7 | 1.9 | 23.7 | 14.8 | 15.5 | 21.2 | 22.4 | 5.4 | 1.9 | -0.1 |
|
| liquides | 4.7 | 1.6 | -2.9 | -1.9 | -11.2 | -9.1 | -4.2 | 0.9 | -7.7 | -16.3 | -7.8 | -7.3 | -9.9 | 4.1 | 0.7 | 1.8 |
|
| sifflantes | 8.0 | 9.0 | 8.4 | 3.7 | 7.6 | 4.1 | -9.0 | -0.9 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | -1.5 | 1.0 | -4.4 | -0.3 |
|
| En syllabe accentuée, traitement des sous-types de s | |||||||||||||||||
| « circonflexe » | -5.3 | -1.9 | 6.6 | -3.0 | 11.9 | -5.2 | -18.2 | -20.5 | 0.8 | -3.5 | -3.4 | -0.3 | -16.5 | -10.7 | -8.0 | -14.8 |
|
| prononcé | -9.7 | -3.6 | -1.1 | 5.2 | 0.0 | 15.7 | 29.2 | 4.9 | 11.6 | -1.1 | 5.1 | 19.2 | 37.3 | 42.5 | 9.5 | 7.3 |
|
| final | 12.0 | 19.0 | 14.1 | 7.8 | 8.7 | 3.9 | -13.7 | -0.1 | 7.3 | 2.3 | 11.2 | 7.1 | 3.2 | -0.3 | -3.1 | -3.3 |
|
| En syllabe inaccentuée, traitement des sous-types de s | |||||||||||||||||
| « circonflexe » | -0.7 | 2.9 | 1.3 | 10.0 | 41.1 | -18.9 | 28.1 | 6.7 | 35.1 | 0.3 | 17.0 | 25.6 | 6.2 | 14.3 | 16.4 | -1.5 |
|
| prononcé | 3.4 | -9.0 | -7.2 | 0.9 | -17.3 | -2.2 | 0.6 | -2.9 | -4.9 | 8.7 | 1.7 | 10.2 | -1.3 | 10.0 | -0.9 | 7.7 |
|
| final | 15.6 | 12.5 | 1.6 | 16.8 | 25.3 | 12.2 | 22.3 | 4.7 | 26.0 | 11.7 | 33.0 | 19.8 | 14.4 | 4.6 | 14.7 | 2.7 |
|
| En syllabe inaccentuée, o/a/e + u + consonne | |||||||||||||||||
| l vélarisé | 12.1 | 8.9 | -1.7 | 23.8 | 14.0 | 8.8 | 4.5 | 0.4 | 3.6 | -10.0 | 7.6 | 18.6 | -0.9 | -6.1 | -6.5 | -5.8 |
|
| Pas d’l vélarisé | 0.5 | 1.8 | -4.7 | -5.7 | -24.9 | -13.5 | -5.3 | -0.7 | -9.4 | -26.7 | -9.4 | -6.6 | -4.6 | 1.6 | -1.3 | -1.7 |
|
Footnotes: